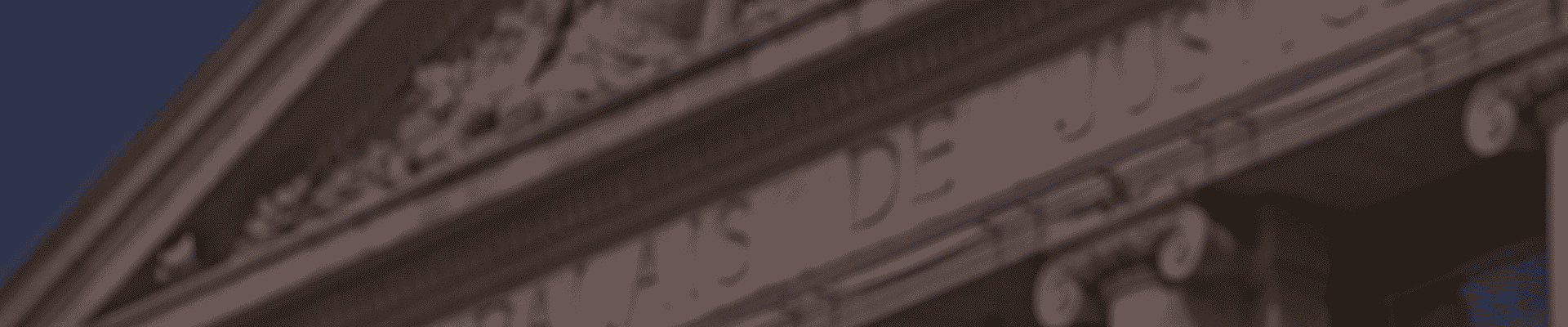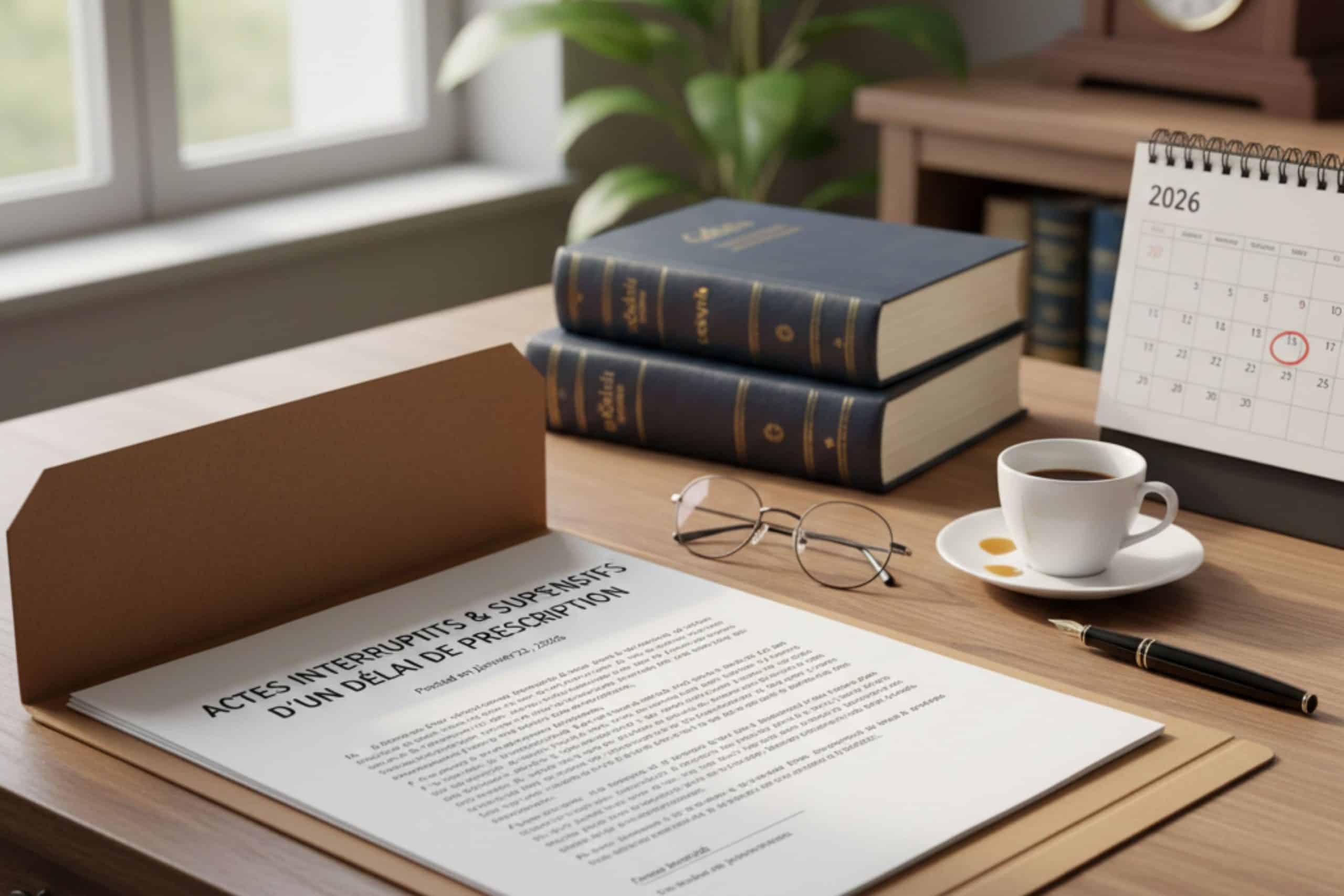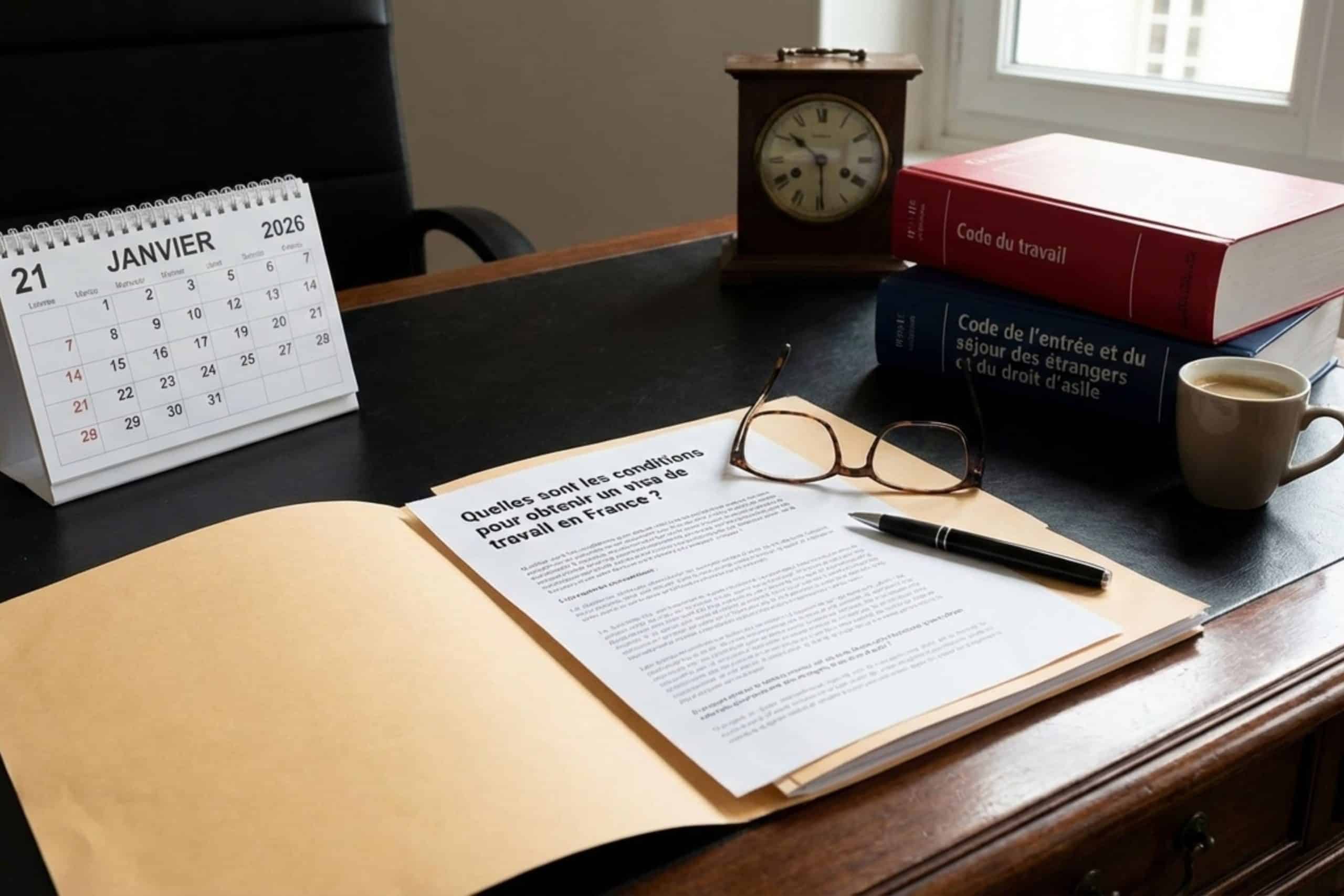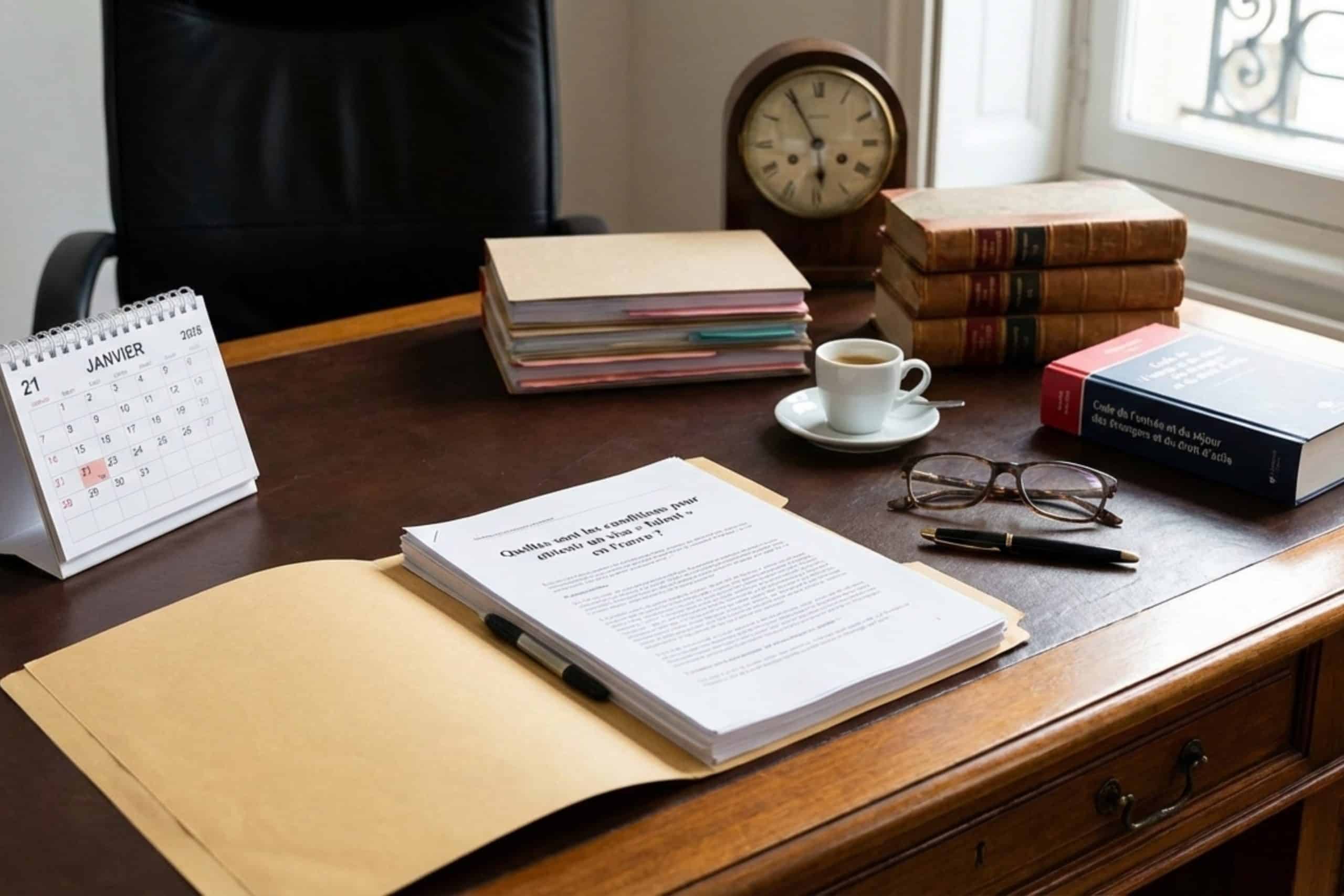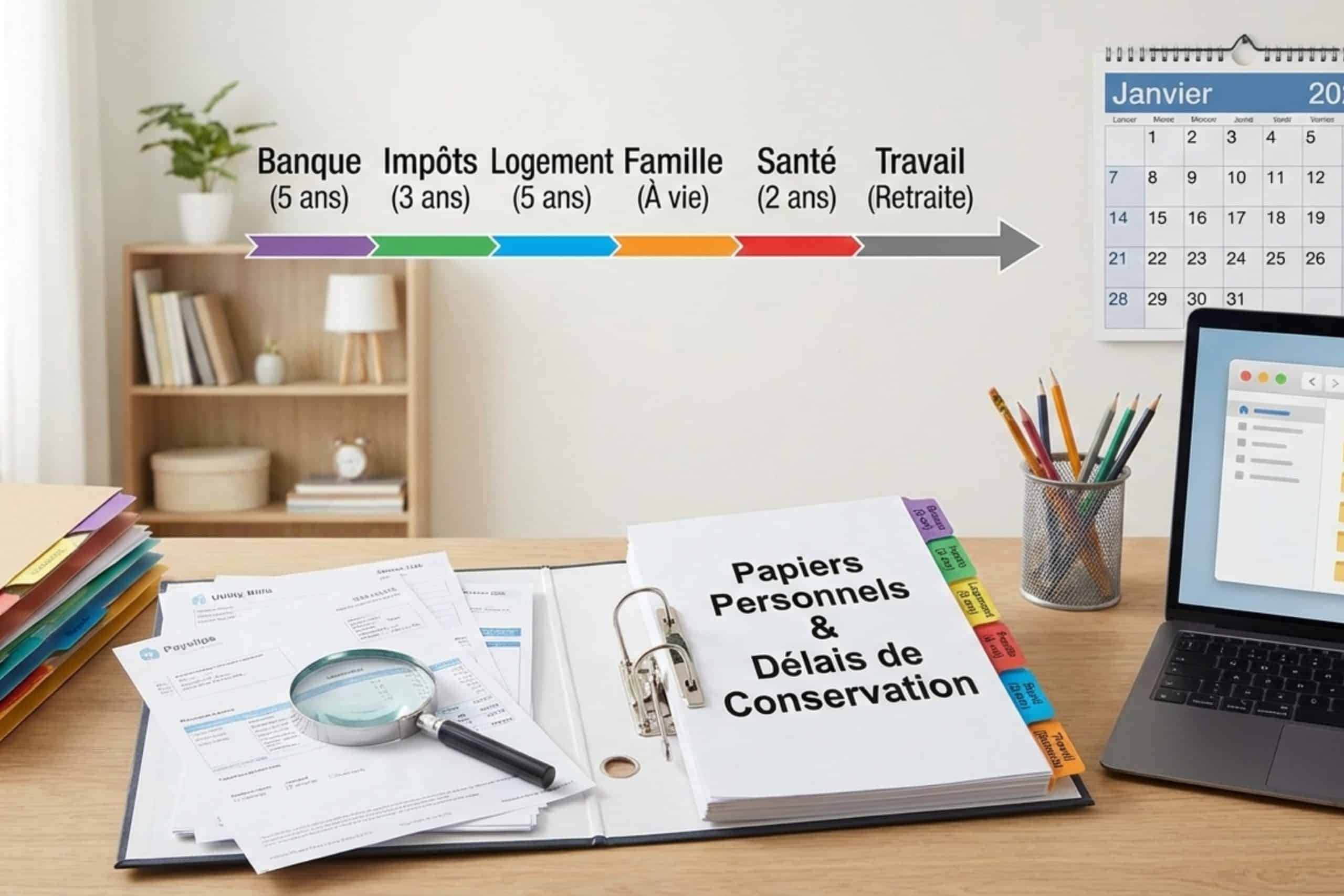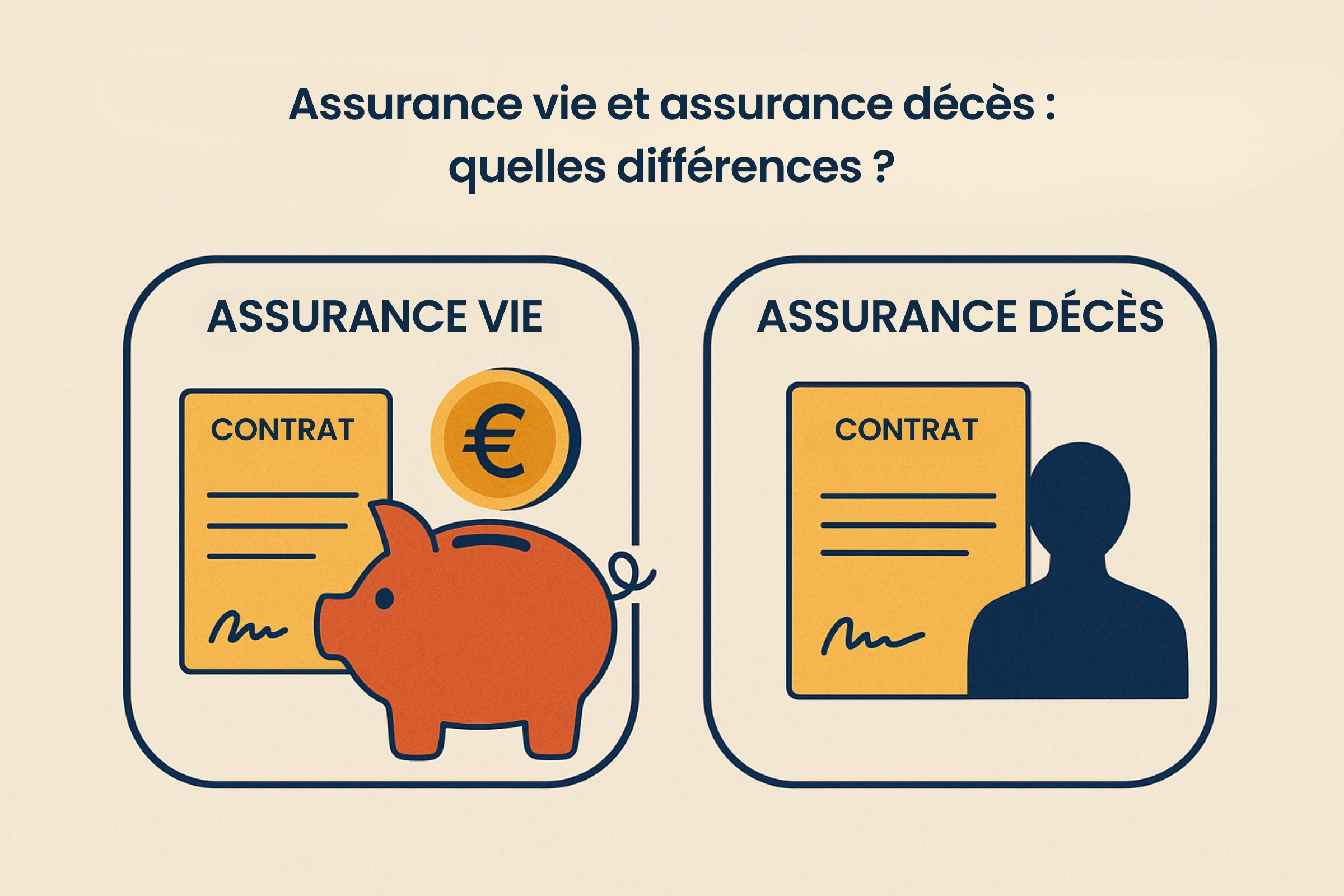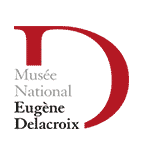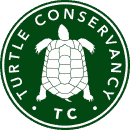Введение
Отказ от пересмотра шкалы подоходного налога, повышение ставки PEL, изменение метода расчета DPE в пользу электрического отопления, повышение минимальной заработной платы… Узнайте, что изменится для вас в начале 2026 года.
Налоги и деньги
Пожертвования в виде вещей и денежных сумм: теперь декларация должна подаваться онлайн
С 1 января 2026 года декларация о дарении (денежных сумм, движимого имущества — предметов искусства, ювелирных изделий, автомобилей и т. д., акций) между физическими лицами должна будет подаваться исключительно в электронном виде, за некоторыми исключениями, через специальный телесервис налоговой администрации, доступный в личном кабинете на сайте impots.gouv.fr.
PEL: повышение ставки вознаграждения
Сберегательные счета на жилье (PEL), открытые с 1 января 2026 года, имеют процентную ставку 2%, по сравнению с 1,75% для счетов, открытых на 1 января 2025 года.
Следует отметить, что ставка вознаграждения по сберегательному счету на жилье устанавливается при его открытии.
Изменение законной процентной ставки
Законная процентная ставка используется для расчета штрафов в случае просрочки платежа кредитору. Ставки, применимые в первом полугодии 2026 года, были установлены постановлением от 15 декабря, опубликованным в Официальном журнале от 26 декабря 2025 года. Они применяются с 1 января 2026 года.
Постепенный запрет «вечных загрязнителей» в некоторых продуктах
С 1 января 2026 года будет запрещено производство, импорт, экспорт и реализация следующих продуктов, содержащих ПФАС:
- косметика,
- смазки (покрытие под лыжами),
- одежда, обувь и их водоотталкивающие средства (за исключением защитной одежды и обуви, такой как военная или пожарная).
Эта мера направлена на защиту населения и окружающей среды от рисков, связанных с перфторалкильными и полифторалкильными веществами (PFAS).
Экологический и энергетический переход
Диагностика энергетической эффективности: изменение расчета для жилых помещений с электрическим отоплением
Расчет диагностики энергетической эффективности (DPE) изменится с 1 января 2026 года. Постановление от 13 августа 2025 года изменяет коэффициент пересчета электроэнергии в DPE.
Это изменение позволит улучшить DPE некоторых жилых помещений, отапливаемых электричеством. Ни одно жилое помещение не потеряет свою категорию.
Все DPE или энергетические аудиты, составленные с 1 января 2026 года, будут автоматически включать новый коэффициент. Те, которые были выпущены в 2025 году и ранее, останутся действительными и могут быть бесплатно обновлены без повторного визита диагностика на веб-сайте Observatoire DPE-Audit de l’Ademe.
Кроме того, закон «Климат и устойчивость» обязывает проводить DPE для всех многоквартирных жилых зданий на уровне здания с 1 января 2026 года для кондоминиумов менее 50 квартир.
Помощь в покупке электромобиля: увеличение сумм для домохозяйств
В 2025 году премия «Coup de pouce véhicules particuliers électriques» заменила экологический бонус.
Правительство объявило о продолжении в 2026 году поддержки покупки новых электромобилей домохозяйствами в рамках системы сертификатов энергосбережения (CEE).
Помощь на покупку электромобилей может составить (ориентировочные суммы):
- 5 700 евро для малообеспеченных семей,
- 4 700 евро для семей со скромным доходом, не относящихся к категории малообеспеченных,
- 3 500 евро для остальных семей.
Дополнительная премия для автомобилей с аккумуляторами европейского производства может составить от 1 200 до 2 000 евро.
Кроме того, повышены предельные уровни доходов, определяющие категории семей со скромным доходом и семей, испытывающих энергетическую нестабильность.
Автомобильный штраф
«Автомобильный штраф» включает в себя два налога, взимаемых с некоторых легковых автомобилей:
- налог на массу в рабочем состоянии («штраф за массу»),
- налог на выбросы углекислого газа («штраф за CO2»).
С 1 января 2026 года штраф за выбросы CO2 применяется при выбросах от 108 г CO2/км, а последний диапазон штрафа установлен на уровне 80 000 евро при выбросах свыше 191 г CO2/км.
Штраф за массу также изменится с 1 января 2026 года, при этом порог его введения будет снижен до 1,5 тонны.
Кроме того, с 1 января 2026 года эти два налога будут распространяться на транспортные средства категории N1 типа «грузовик», классифицированные как внедорожные и имеющие не менее пяти сидячих мест.
Кредит на переезд +: изменение предельных уровней доходов
Беспроцентный кредит на переезд (или «PAR +») позволяет финансировать определенные работы по повышению энергоэффективности частного жилья, используемого в качестве основного места жительства.
Пределы доходов, применимые к получателям предложений PAR +, обновляются с 1 января 2026 года.
Кредит
Изменение процентных ставок по ипотечным кредитам
С 1 января 2026 года пороговые значения процентных ставок (максимальная законная годовая процентная ставка) по ипотечным кредитам изменятся по сравнению с предыдущим периодом.
Пособия и выплаты
Повышение минимальной заработной платы
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата (Smic) повышается на 1,18 %.
- Часовой минимальный размер заработной платы увеличивается до 12,02 евро,
- Месячный минимальный размер заработной платы составляет 1 823,03 евро.
Социальное страхование: повышение потолка на 2%
С 1 января 2026 года потолок социального страхования (PASS) составляет 48 060 евро, а месячный предельный уровень — 4 005 евро, что соответствует увеличению на 2 %.
Переоценка пенсий по старости, минимальных социальных выплат и минимальных пенсий
Суммы базовых пенсий, некоторых минимальных пенсий и некоторых минимальных социальных выплат переоцениваются на 0,9 % с 1 января 2026 года.
Введение дополнительного отпуска по рождению ребенка
С 1 января 2026 года вводится дополнительный отпуск по рождению ребенка продолжительностью 1 или 2 месяца по выбору родителя.
Каждый родитель сможет воспользоваться этим правом с 1 июля 2026 года.
Приостановка реформы пенсионного обеспечения
Закон о финансировании социального обеспечения на 2026 год приостанавливает ускоренный график реформы пенсионного обеспечения 2023 года.
Другие изменения
Изменение тарифов на почтовые марки
Тарифы на почтовые отправления и посылки в среднем увеличиваются на 7,4 % с 1 января 2026 года.
Налоги и доходы
Отсутствие пересмотра шкалы подоходного налога
В связи с отсутствием закона о бюджете на 2026 год шкала подоходного налога не пересматривается.
Отмена дифференцированного налога на высокие доходы
Дифференцированный налог на высокие доходы (CDHR) прекращает действовать 31 декабря 2025 года.
Прекращение действия налогового кредита на установку зарядных станций для электромобилей
Налоговый кредит на установку зарядных станций прекращает действовать 31 декабря 2025 года.
Cabinet BRAHIN Avocats
Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE
Fedor ILIN
Master’s Degree in Business Law – Specialization in Transport and Aviation Law
Université Toulouse 1 Capitole
Email : fedor.ilin@brahin-avocats.com
1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)
Tel : +33 493 830 876 / Fax : +33 493 181 437
www.brahin-avocats.com