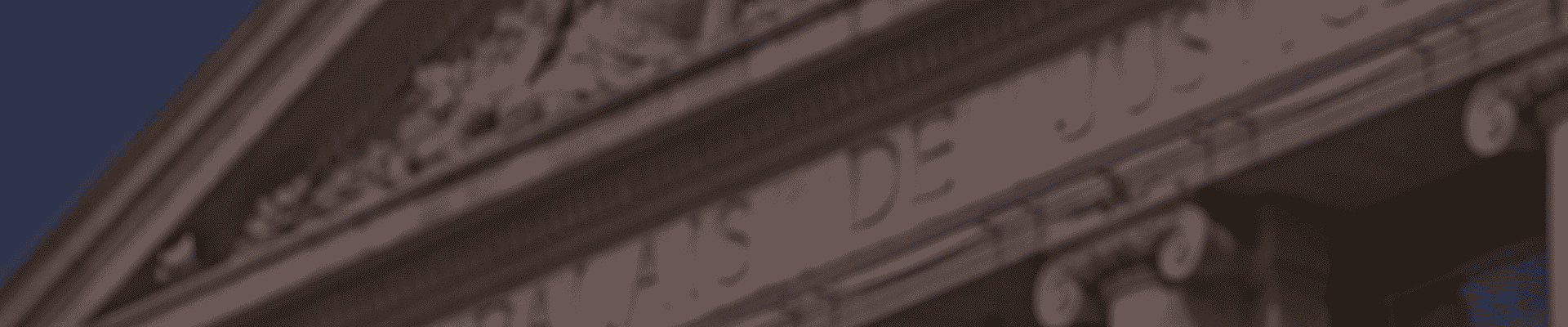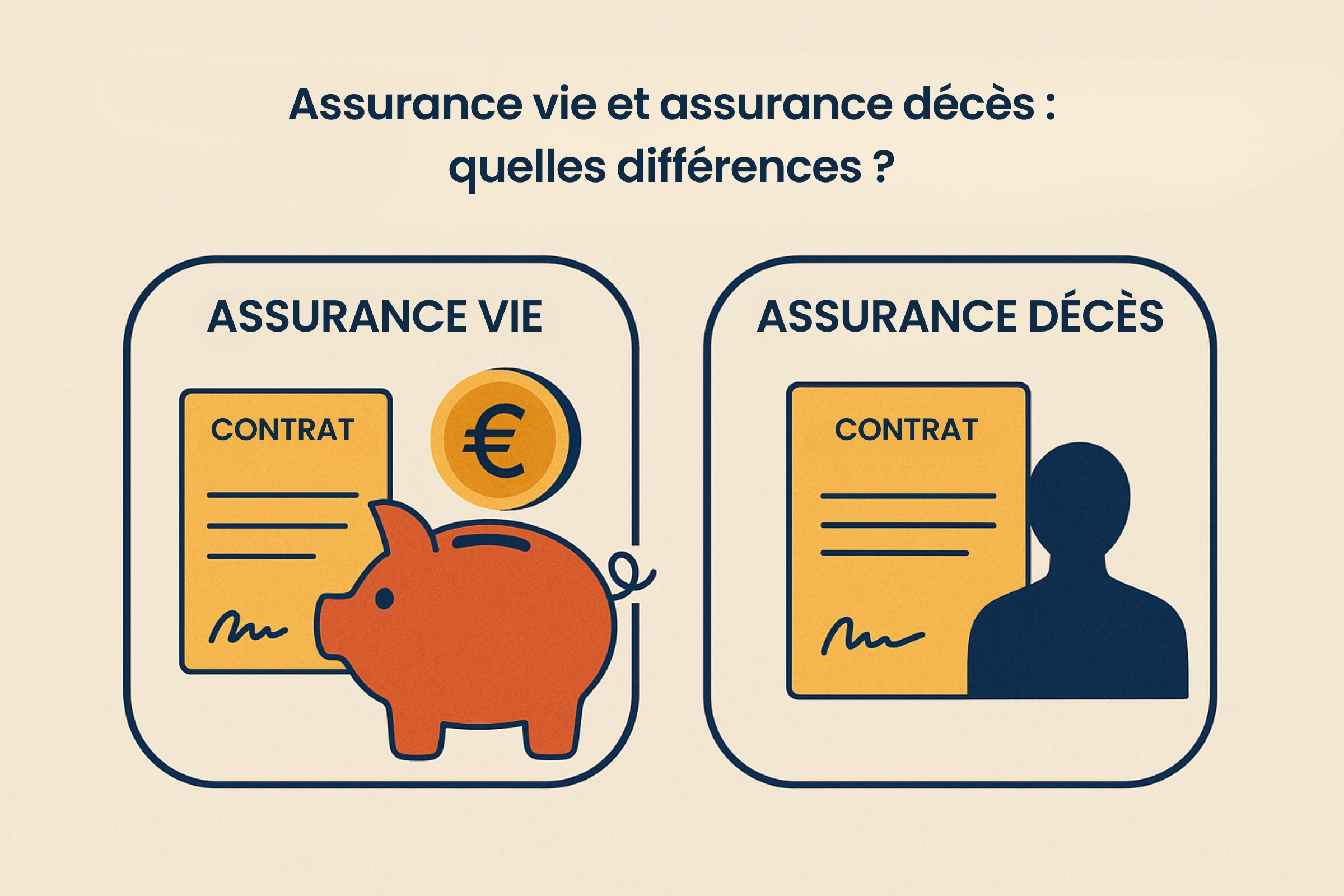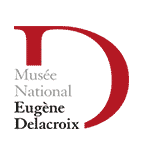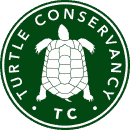Successions ouvertes avant le 17 août 2015
Principe
Pour les successions ouvertes avant l’entrée en vigueur du règlement Successions, il convient de distinguer la loi applicable à la forme du testament ou du contrat de celle applicable au fond de la succession.
Les règles de conflit restent globalement similaires à celles du droit international privé classique.
- Dispositions à cause de mort
- Loi applicable à la forme
La forme du testament est régie par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui reconnaît la validité d’un testament conforme à certaines lois (lieu de rédaction, nationalité ou domicile du testateur, etc.).
Le testament international est encadré par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 : il doit respecter un formulaire spécifique, être signé devant deux témoins et enregistré.
La Convention de Bâle du 16 mai 1972 traite de l’inscription des testaments.
Les pactes successoraux, sauf exceptions, échappent à la convention de 1961 et relèvent du droit international privé commun.
La loi applicable peut être déterminée en fonction de la nationalité commune des parties ou de leur choix de loi.
La doctrine admet que certains actes, notamment une donation entre époux, puissent être requalifiés en dispositions à cause de mort, nécessitant alors l’identification de la loi applicable.
- Loi applicable au fond
Le fond de la succession suit les règles de conflit de lois applicables aux donations entre vifs.
La loi ainsi désignée définit l’étendue de la liberté testamentaire, notamment la présence ou non d’une réserve héréditaire.
Le testateur peut, sous conditions, choisir la loi nationale applicable à sa succession, mais ce choix est nul s’il vise à contourner les règles impératives.
Tout testament doit exprimer clairement la volonté du testateur quant au partage des biens.
Exemple :
Un Américain résident en France décède en y laissant un testament soumis à la loi de New York. Il lègue tous ses biens à une association.
Ses enfants français peuvent invoquer la réserve héréditaire prévue par le droit français pour contester ce legs.
Formalités :
Le lieu de conservation du testament détermine les formalités à respecter.
Un testament trouvé en France doit respecter la forme exigée par la loi française (art. 1001 C. civ.), tandis qu’un testament conservé à l’étranger suit les formalités locales (ex. : homologation judiciaire).
Il ne faut pas surestimer l’effet de l’exequatur : un jugement étranger ne suffit pas toujours à permettre la transmission de biens situés en France.
Même si un testament est reconnu à l’étranger, certaines formalités doivent être accomplies en France, notamment pour l’administration fiscale.
Selon l’article 1007 C. civ., le légataire universel ne peut exercer ses droits sans envoi en possession, ce qui implique un dépôt du testament chez un notaire français, y compris s’il a été validé à l’étranger.
En pratique, ce dépôt permet d’assurer la sécurité juridique, notamment vis-à-vis des services fiscaux.
Deux cas illustrent ces principes :
– Greta Jensen, danoise, décédée à Copenhague en 2015 : la loi danoise s’applique à sa succession selon le règlement européen.
– Liliane Martin, française domiciliée à Londres, décédée en 2014 : son testament rédigé selon le droit anglais s’applique aux biens situés en Angleterre.
En revanche, la loi française s’applique aux biens situés en France, car la succession a été ouverte avant le 17 août 2015, date d’entrée en vigueur du règlement.
Exécution testamentaire
L’exécution testamentaire, c’est-à-dire la mise en œuvre des volontés du défunt par une personne désignée, est régie par la loi successorale applicable.
Elle s’apparente à l’administration des biens successoraux.
Pactes successoraux
Les pactes successoraux – accords conclus du vivant pour organiser la succession – sont admis en droit français mais à titre exceptionnel et sous conditions strictes.
Le règlement européen permet toutefois de reconnaître ces pactes s’ils sont valables selon la loi étrangère applicable et ne sont pas contraires à l’ordre public international.
Lorsque la succession est régie par une loi étrangère, la validité des donations et legs est appréciée selon cette loi.
Depuis la réforme française du 23 juin 2006, le droit interne a évolué, notamment en matière de libéralités entre époux et de pactes familiaux.
Si la loi applicable est la loi française, certaines règles spécifiques s’imposent, notamment pour la renonciation à succession ou la réduction des libéralités (protection de la réserve héréditaire).
Ces exigences peuvent différer des règles étrangères, ce qui complique les successions internationales.
Dans tous les cas, la loi successorale s’applique selon le règlement européen, en fonction de la résidence habituelle du défunt ou de la loi qu’il a choisie.
- Donations et trusts
- Donations ordinaires
Les donations ordinaires, qui ne s’inscrivent pas dans un contexte successoral ou familial particulier, sont traitées comme des contrats.
Elles sont donc soumises aux règles du droit international privé applicables aux contrats, soit le règlement Rome I, soit la Convention de Rome, selon leur date.
- Donations à caractère familial
Les donations entre époux ou entre parents et enfants obéissent à des règles plus complexes.
Si la donation concerne des biens présents et est réalisée pendant le mariage, elle relève du régime matrimonial.
En revanche, si elle prend effet au décès, elle est soumise à la loi successorale.
Les donations-partages, qui permettent de répartir son patrimoine de son vivant entre ses héritiers présomptifs, relèvent également de la loi successorale, notamment pour vérifier si elles respectent la réserve héréditaire ou doivent être réduites.
- Trusts
Le trust est un mécanisme anglo-saxon par lequel une personne transfère des biens à un trustee chargé de les gérer pour le compte de bénéficiaires.
En droit français, cette institution n’a pas d’équivalent direct, ce qui soulève de nombreuses difficultés.
Si le trust est testamentaire, il est soumis à la loi successorale.
S’il est entre vifs, sa qualification dépend du droit français, qui a tendance à les assimiler à des donations ou à des legs déguisés.
Dans ce cas, les règles françaises sur la réduction des libéralités et la réserve héréditaire peuvent s’appliquer.
Lorsque la loi française est applicable à la succession, la situation devient complexe.
Le droit français impose des critères stricts pour classer les libéralités (donation, testament, legs) et peut requalifier un trust en donation déguisée si le disposant s’est dessaisi irrévocablement de ses biens avant son décès.
Si ce dessaisissement est réversible, le trust sera plutôt considéré comme un testament déguisé.
La jurisprudence française est stricte : elle examine au cas par cas le type de trust, sa révocabilité, le moment du transfert et le rôle du trustee, pour vérifier le respect de la réserve et de la quotité disponible.
Un exemple illustre ces enjeux : Mike Brown, citoyen américain, a établi un trust testamentaire aux États-Unis en 1998.
Il est décédé en 2014 à Paris, où il résidait depuis 2003.
Sa succession a donc été ouverte en France, et sa succession mobilière est soumise à la loi française.
Or, le trust prévoyait que les trustees pouvaient vendre les biens et en distribuer les revenus librement.
Cela entre en conflit avec le droit français, qui protège la réserve des héritiers.
Même si le trust est valable à l’étranger, il ne peut priver les héritiers réservataires de leurs droits.
Le droit français impose également le respect de la quotité disponible, et certains ont proposé d’assimiler les bénéficiaires d’un trust à des légataires.
Mais cette approche reste juridiquement incertaine.
La France n’a pas ratifié la Convention de La Haye de 1985 sur le trust, ce qui empêche sa reconnaissance automatique.
Néanmoins, certains tribunaux français acceptent de reconnaître un trust s’il respecte la loi successorale française et est intégré dans un acte notarié.
En l’absence de ratification, les règles restent floues.
Un projet de codification a été proposé dans le projet de Code français de droit international privé de 2022, mais il n’a pas encore été adopté.
Cabinet BRAHIN Avocats
Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE
Camilla Nissen MICHELIS
1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)
Tel : +33 493 830 876